
VIROFLAY, PATRIMOINE MÉCONNU
1880-1930


50 années d’urbanisation galopante
1880, c’est 10 ans après la défaite de Sedan et avec les cicatrices de la guerre on veut oublier aussi les émeutes sanglantes de la Commune de 1871. Un besoin de renouveau se fait sentir, encouragé par une industrie en plein essor et par le développement du chemin de fer qui permet de quitter Paris et son « air vicié », porteur de maladies (Choléra en 1832 et 1849 et Tuberculose qui fait des ravages).
Une élite bourgeoise se fait alors construire des maisons de villégiature pour y passer l’été. On veut profiter de l’air de la campagne à proximité de la capitale comme en témoigne le nom du premier lotissement réalisé à Viroflay en 1898 : « Ma campagne » situé rue du Louvre. A noter que ce nom de rue a son importance : le fondateur des Magasins du Louvre, Alfred Chauchard, donne son appui moral et financier à soixante employés pour leur permettre d’accéder à la propriété individuelle, ceci dans le cadre de la loi Siegfried (1894) qui marque le début d’une politique sociale en France, en autorisant la Caisse des Dépôts et Consignations à prêter de l’argent à des organismes privés afin de construire des habitations.
D’autres lois sociales suivront, qui vont peu à peu démocratiser la villégiature. On a plus que jamais envie d’acquérir une maison, et Viroflay, très attractif avec la présence de la forêt et ses 3 gares (la dernière construite en 1902 à Chaville-Vélizy) va connaître une forte croissance démographique : 1600 habitants en 1880, ils seront plus de 9000 en 1930, date autour de laquelle apparaissent les premiers immeubles collectifs.
Tout le panel de l’habitat individuel y est représenté, de la grande villa en meulière au modeste pavillon.
Il s’agit là d’un patrimoine exceptionnel par sa densité (quelque 800 meulières selon Monsieur le Maire) et surtout par son originalité.
Gare de Viroflay, carte postale
L’originalité architecturale de cet habitat
Elle tient en trois principes qui résument la mode et les sensibilités de l’époque : la polychromie, l’ornementation et le pittoresque, qui vont être modulés selon les tendances artistiques qui jalonnent cette période, Art Nouveau, Régionalisme et Art Déco. Toutes les maisons, implantées au coeur d’un jardin pour profiter de l’air et de la vue, participent d’une idée, celle de la ville polychrome, prônée par deux architectes qui ont beaucoup influencé les générations qui les ont suivis.
-
Charles Garnier (1825-1898) célèbre depuis sa création de l’Opéra
-
Eugène Viollet-Leduc (1814-1872) grand restaurateur d’édifices (Notre-Dame, Carcassonne, etc).
La polychromie en architecture n’est pas vraiment une nouveauté puisque, dans l’Antiquité comme au Moyen-Age, les édifices religieux et les maisons étaient souvent parés de couleurs vives.
Durant cette cinquantaine d’années, la polychromie va se décliner à l’envi avec l’emploi de trois matériaux colorés : la meulière, la brique et la céramique.

Rue Marguerite, Viroflay
« (...) je m'imagine le jour où les tons fauves de l'or viendront piqueter les monuments et les constructions de notre Paris ; je m'imagine les tons chauds et harmonieux qui frémiront sous le regard charmé (...) ; les fonds des corniches reluiront de couleurs éternelles, les trumeaux seront enrichis de panneaux scintillants, et les frises dorées courront le long des édifices ; les monuments seront revêtus de marbre et d'émaux, et les mosaïques feront aimer à tous et le mouvement et la couleur. Ce ne sera plus le luxe faux et mesquin ; ce sera l' opulence, ce sera la sincérité. »
Charles Garnier, A travers les arts : Causeries et Mélanges, 1869, p.183.
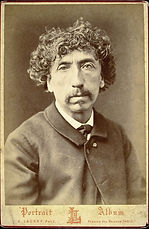



La meulière
Pour jointoyer cette pierre irrégulière les maçons ont recours à plusieurs techniques :
-
l’opus incertum composé de moellons irréguliers noyés dans un liant à joints creux.
-
le jointoiement rubanné qui entoure les moellons d’un joint saillant.
-
le rocaillage très recherché qui consiste à remplir les joints par des éclats plus petits et colorés (meulière, coquillages, mâchefer, céramique). Tout un art !
opus incertum
Opus incertum
Jointoiement rubanné
Rocaille
La brique
2ème matériau coloré, la brique, dont la production a explosé avec la Révolution industrielle, ce qui facilite son utilisation. C’est un matériau dont les nuances varient selon l’origine et la cuisson et qui met la meulière en valeur : la brique souligne les baies, les différents niveaux, habille les piliers d’entrée et couronne les toitures d’un épi de faîtage ouvragé. Pour orner les façades, les artisans rivalisent dans des jeux de briques esthétiques et variés (boulangerie avenue du général Leclerc et hôtel des trois gares, place de Verdun) et dans des appareillages fantaisie (en accordéon ou en « dents de loup »). Parfois même, la brique prend le pas sur la meulière comme pour la « Maison de René Clair » rue du Louvre.

Hôtel des Trois Gares, place de Verdun, Viroflay
 |  |  |
|---|---|---|
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
 |  |

Gare de Chaville - Vélizy à Viroflay, céramique architecturale par H. Boulenger, Fabrique de Choisy le Roi

Avenue des combattants, Viroflay
La céramique
Autre matériau coloré : la céramique. Elle est très en vogue depuis l’Exposition Universelle de 1878, où a été présentée toute une collection de céramiques ottomanes d’Iznik (ville de Turquie, anciennement Nicée) datant du 16ème siècle. (aujourd’hui au Musée de la Renaissance à Ecouen). On a alors été émerveillé par les décors à dominante végétale, parfois accompagnés d’oiseaux, ainsi que par les coloris très vifs de bleu, de vert et de rouge qui vont être une source d’inspiration pour les céramistes occidentaux : carreaux, frises, cabochons, rosaces vont se multiplier, accompagnés de plaques qui portent des noms de femmes, de fleurs, ou d’arbres.
Ces céramiques architecturales proviennent de fabriques de renom : Hippolyte Boulenger à Choisy le Roi (gare de Chaville-Vélizy), Gentil et Bourdet à Boulogne-Billancourt connue pour ses grès flammés. Léon Parvillée (1830-1885) très remarqué lors des Expositions Universelles de 1867 et 1878, s’illustre dans la veine orientaliste peu ou pas représentée à Viroflay. A noter que tous les propriétaires ne partagent pas cet engouement pour la céramique et lui préfèrent parfois une décoration sculptée dans la pierre blanche comme cette «chimère-salamandre» (?) avenue des Combattants.
Les architectes
Ils sont nombreux et souvent talentueux.
On peut parfois lire leurs noms sur une plaque Deux d’entre eux, d’origine versaillaise, sont particulièrement renommés pour la réalisation de maisons bourgeoises à Versailles, au Chesnay et à Viroflay :
Léon Bachelin (1867-1929) et Auguste Welsch (1881-1950). Aujourd’hui encore, on admire le décor foisonnant d’une « Bachelin » ou la construction peut-être plus sobre d’une maison signée Welsch.

Maison en pierres meulières par l'architecte Léon Bachelin

Villa par l'architecte Auguste Welsch, Viroflay
Les architectes proposent différents types de maisons. Selon le nombre d’étages et d’ouvertures, on distingue la maison bourgeoise et la villa (un ou deux étages) alors que le pavillon ne comporte pas d’étage. Un style « francilien » va peu à peu s’imposer : une avancée en façade terminée par un pignon de forme triangulaire. Ils proposent aussi l’ornementation qui va avec la maison : la brique, la céramique et un autre élément, la ferronnerie. Ferronnerie de la grille et de la marquise de verre placée au-dessus de la porte d’entrée.

Avenue Gaston Boissier, Viroflay
Ce décor est plus ou moins influencé par les courants artistiques Art Nouveau et Art Déco. Pour faire très court, l’Art Nouveau (jusqu’en 1910) privilégie les lignes courbes et les arabesques conjuguées à des motifs floraux, alors que l’Art Déco se reconnaît à ses formes géométriques et à des motifs stylisés. Il y aurait encore à dire sur ces ferronneries, d’autant qu’un Chavillois, M. Lefèvre a réalisé une impressionnante collection de ferronneries de portes et fenêtres à Chaville et à Viroflay.
Toujours à la recherche d’originalité et de pittoresque, (3ème principe de l’époque), les architectes vont aussi s’inspirer des styles régionaux (d’où le nom de Régionalisme), en particulier de celui de Normandie, riche en décor. C’est le style néo-normand.

Villa Bel Air, Viroflay

Le Régionalisme et le style néo-normand
Né sur les côtes du Calvados dans la seconde moitié du 19ème siècle, il est destiné au départ à la haute société qui fréquentait les lieux de villégiature. Peu à peu, la clientèle s’est élargie à de nouvelles classes sociales et le « genre normand » s’est répandu dans l’intérieur de la Normandie
et dans la région parisienne.
L’emblème décoratif du style normand est le pan de bois, vrai ou faux : selon la bourse du commanditaire, il peut être simulé par un simple enduit peint ou remplacé par du ciment moulé.
Le toit en tuile débordant a très souvent un versant coupé, la demi-croupe, qui permet au vent d’ouest d’emmener les fumées. Parfois aussi, les extrémités du toit sont légèrement relevées pour permettre d’éloigner l’écoulement des eaux pluviales. Deux exemples de fonctions utilitaires liées au climat et qui deviennent une mode. Les pièces de charpente souvent peintes en blanc sont apparentes et jouent un rôle autant décoratif qu’utilitaire : les aisseliers qui portent le débordant d’un toit, illustrent ce double aspect.
Derniers détails importants qui donnent du relief à la maison : les balcons de bois blanc en saillie, ainsi que les bow-windows (fenêtre en saillie) d’origine anglo-normande, qui permettent de profiter du paysage et en même temps d’être vu.
A noter que dans cette recherche de régionalisme, on trouve aussi à Viroflay quelques maisons de style néo-basque (toit à faible pente dont un pan est plus court que l’autre et pans de bois vrais ou simulés).
Il y a donc dans les maisons viroflaysiennes, une grande variété qui illustre une période importante dans l’histoire de l’Architecture .
Ainsi s’achève cet aperçu du bâti viroflaysien de la Belle Epoque et de l’entre- deux guerres, réalisé sur une large centaine de maisons de notre ville. C’est un patrimoine incontestable et pourtant souvent sous-estimé, voire sacrifié au modernisme, sous la pression immobilière... Il en reste encore beaucoup et nous espérons découvrir d’autres pépites… Notre devise : connaître pour préserver. Rejoignez nous !
Bibliographie :
-
« Paris, capitale de l’ornement », Conférence de Simon Texier à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine (2014)
-
« A travers les arts, causeries et mélanges » Charles Garnier (1869).
-
« Viroflay au 20ème siècle » Gérard C. Martin, Maire honoraire de Viroflay (2011).
-
« Découvrir les maisons de villégiature » Publication du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
-
« La belle meulière, reine d’un autre Versailles » Anne-Marie Royer-Pantin (2022)
-
« Le style néo-normand en architecture, 19ème - 21ème siècles, Patrice Gourbin (Publication du C.A.U.E. du Calvados).
-
« Léon Parvillée, architecte-décorateur » 1996 Paris IV, Caroline Gronier-Baillart.





